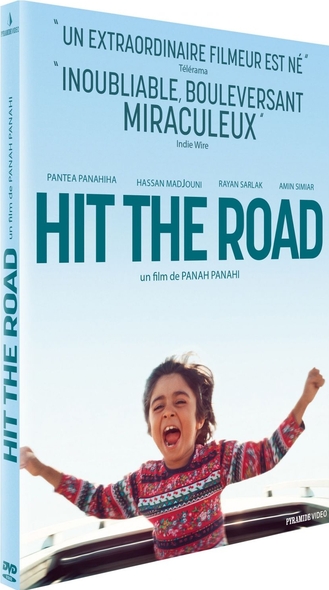Le film est sorti il y a déjà une quinzaine de jours, et avait été particulièrement remarqué au festival de Gérardmer, qui consacre le film fantastique. Un film bien ancré dans son territoire argentin, mais qui ne se contente pas de le commenter, comme un certain nombre de films d’horreur contemporains d’auteurs - on appelle ça l’”elevated horror”, qui sont souvent les réceptacles tout trouvés de réflexions sociétales un peu répétitives: sur les femmes, sur les jeunes, sur les minorités en général.
Alors ça commence dans la pampa argentine, grands paysages plats et agricoles battus par le vent. Deux employés d’une riche exploitation découvrent dans des taillis le corps affreusement démembré d’un guérisseur, seule instance à pouvoir débarrasser le monde d’un démon apparemment bien connu, et qui se trouve au début de notre histoire dans le corps d’un pauvre hère, gisant dans une cabane voisine avec sa mère et son petit frère. Un corps putréfié littéralement, menaçant de crever, et de libérer cette instance maléfique, capable de s’installer dans n’importe quel corps - humain ou animal - et de le transformer en arme redoutable. Il faut avoir le cœur un peu accroché, surtout devant les vingt premières minutes qui sont les plus étonnantes et les plus atroces aussi, et qui réussissent à maintenir l’attention du spectateur en proposant une mécanique horrifique neuve et imprévisible : ce corps boursouflé, cette crainte partagée des personnages qui connaissent déjà, à l’inverse du spectateur, le fléau à venir, et cette violence qui surgit d’un coup, notamment dans une scène en extérieur devant un troupeau de chèvre entre une femme enceinte et son exploitant de mari qui est assez sidérante.
Je me suis fait la réflexion devant cette séquence en particulier, que le film d’horreur m’ennuie souvent parce que ses motifs sont tellement répétitifs, et qu’il repose sur une réception à mon sens très étrange : qui engage à la fois de la reconnaissance et de la peur, deux émotions concurrentes, qui s’articulent rarement bien. De fait, la surprise que provoque d’abord When evil lurks s’affadit malheureusement au fil du récit, qui se choisit un personnage, et embarque sa famille et ses enfants dans une course plus convenue.
Résister
Le territoire argentin y est plus qu’un décor: cette campagne d’abord, peuplée par des riches blancs propriétaires d’immenses terrains qui exploitent des pauvres d’origine amérindienne - ce substrat là n’est pas appuyé mais joue nettement dans l’intérêt qu’on porte au film. C’était aussi le cas pour un précédent long film dont j’avais parlé ici il y a quelques mois, Los Delincuentes, vrai faux film de braquage, une petite merveille, et aussi à sa manière un film qui travaillait singulièrement le cinéma de genre. Deux signes d’une vitalité exceptionnelle du cinéma argentin - les Cahiers du cinéma lui ont consacré un dossier récemment. On y lisait que dans les années 90 avait émergé un mouvement assez proche de la Nouvelle Vague, avec des films inventifs et peu chers, que cette avant-garde avait finalement amorcé un système de financement avantageux, et que co-existaient désormais un cinéma de la marge et un cinéma du milieu, tous les deux très vivants, et exportateurs à l’étranger. Un système en danger, avec l’arrivée au pouvoir de Javier Milei, qui fait régulièrement peser sur le cinéma argentin des menaces de coupes drastiques, comme sur les autres secteurs culturels.
Ce qui me paraît intéressant c’est combien ces films, Los Delincuentes, When Evil lurks, mais aussi un autre qui s’appelait Trenque Lauquen, portent en effet en eux, dans leur forme, les signes d’une grande vitalité, celle d’une vraie croyance dans le romanesque, comme une arme de résistance.